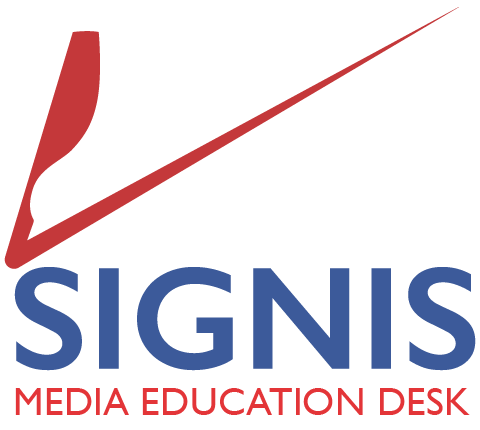Les réseaux sociaux, une menace pour la démocratie

Le modèle économique propriétaire érode les institutions démocratiques. Il est temps de le changer.
par Justin Rosenstein *
En 2008, j'ai contribué à la création du bouton « J'aime » de Facebook. Nous souhaitions inclure un outil permettant de créer des liens plus humains. Plus de dix ans plus tard, nous disposons de preuves accablantes que les réseaux sociaux, en privilégiant la sympathie au détriment de la vérité, ont eu des conséquences inattendues et catastrophiques. Aux États-Unis, une élection sans précédent est imminente, qui deviendra un référendum non seulement sur le leadership politique, mais aussi sur la légitimité de la démocratie. Comment en sommes-nous arrivés là ? En grande partie parce que les réseaux sociaux ont dégradé les relations humaines, réduit la capacité des citoyens à voter lors d'élections libres et équitables, et affaibli la confiance dans la démocratie et ses perspectives d'avenir.
Ce n'est pas une fausse nouvelle. Pour des millions de personnes qui en ont déjà subi les conséquences, ce n'est pas une nouvelle. Nous avons vu comment les réseaux sociaux ont déstabilisé les élections partout dans le monde. Nous avons constaté la polarisation de nos conversations. Nous avons constaté la montée de la dépression et du cyberharcèlement, et comment ils changent la vie de nos enfants. Nous avons entendu les plus anciens employés des réseaux sociaux s'exprimer, moi y compris.
Que n'avons-nous pas vu ? Un changement structurel. Les réseaux sociaux et leurs algorithmes de recommandation de contenu sont conçus pour nous attirer une attention maximale. Plus ils captent notre attention, plus ils peuvent acheter de publicité et plus ils gagnent d'argent. Malheureusement, scandales, accusations et mensonges flagrants sont plus vendeurs que vérité et nuance. Comme je l'ai déjà dit, privilégier le profit au détriment du bien public n'a rien de nouveau. On abat des arbres parce qu'ils valent plus cher morts que vifs. On tue des baleines parce qu'elles valent plus cher mortes que vivantes. Et les réseaux sociaux nous piègent parce que les gens valent plus cher lorsqu'ils fixent un écran que lorsqu'ils profitent pleinement de la vie.
Tant que les entreprises technologiques seront incitées à rechercher le profit maximal, elles produiront des technologies qui récompenseront les actionnaires au détriment de la société. Cela peut paraître absurde, mais elles ont une obligation fiduciaire juridiquement contraignante de le faire. Sans une transformation radicale des incitations commerciales, les entreprises technologiques continueront de dégrader et de mettre en péril l'avenir de la démocratie.
En matière d'élections, les entreprises accusent systématiquement les mauvais contenus et les mauvais utilisateurs. La désinformation et la manipulation existaient bien avant l'apparition des réseaux sociaux, mais la structure de ces derniers et leurs algorithmes les favorisent, en tirent profit et leur permettent de devenir virales. Sur Twitter, les mensonges se propagent six fois plus vite que la vérité. En 2016, Facebook a reconnu que 64 % de la croissance des groupes extrémistes était due à son propre algorithme de recommandation. Une étude de 2020 a révélé que la désinformation sur Facebook est trois fois plus populaire que lors de la dernière élection présidentielle américaine. Les deux candidats ont consacré une partie de leurs fonds à la publicité sur les réseaux sociaux. Biden a inondé Facebook pendant l'été. Trump a réservé des emplacements sur la page d'accueil de YouTube pour début novembre. Depuis juin, les deux candidats ont dépensé 100 millions de dollars en publicités sur Instagram et Facebook combinés.
Cependant, les algorithmes et les incitations des réseaux sociaux font que ce qui devient viral n'est pas du contenu électoral légitime. Il s'agit de mensonges, de peur, de théories du complot fabriquées de toutes pièces et de menaces de violence. Il en résulte une crainte de troubles sociaux le jour du scrutin et les jours suivants. Les tentatives de Twitter et Facebook pour étiqueter les messages les plus outrageusement faux et dangereux sont à la traîne par rapport aux campagnes de désinformation incessantes qui érodent la foi en la démocratie.
Je sais que les réseaux sociaux n'ont jamais eu pour vocation de servir de vecteurs à une propagande politique dangereuse. Mais ils n'ont pas opéré les profonds changements structurels nécessaires, et c'est nous, citoyens, qui en payons le prix. Malgré ce que ces entreprises voudraient nous faire croire, la solution ne consiste pas à recruter davantage de modérateurs ni à améliorer leur capacité à dénicher la désinformation. Ce ne sont que des pansements. Le système est défaillant. Pour que les choses changent, nous devons transformer la structure de gouvernance des entreprises. La solution pour sauver notre démocratie est de leur appliquer les principes démocratiques.
Imaginez, par exemple, si Facebook était responsable devant un Conseil populaire plutôt que devant un conseil d'administration. Ce Conseil populaire, composé d'actionnaires issus de divers secteurs, déciderait des objectifs généraux de l'entreprise, des critères importants et du moment opportun pour embaucher un nouveau PDG. Au lieu de définir la réussite selon des critères économiques, le conseil d'administration pourrait exiger une plus grande prise en compte des paramètres qui renforcent les institutions démocratiques et la vie individuelle. Ces dernières décennies, de nombreux pays ont eu recours à des processus démocratiques aussi avancés pour donner aux citoyens les moyens de changer les choses. En 2015 et 2018, l'Irlande a adopté des amendements à sa Constitution sous la direction d'une Assemblée citoyenne, un échantillon représentatif de la population travaillant selon une collaboration structurée et des processus guidés. En 2020, Taïwan a géré l'épidémie de COVID-19 grâce à des outils de démocratie numérique qui ont renforcé la confiance et la participation.
Cela paraît-il utopique ? Ça l'est, comparé à la situation actuelle. Mais c'est possible. Les entreprises décideront peut-être de changer, mais nous ne pouvons pas attendre qu'elles le fassent. Il est essentiel que les utilisateurs des réseaux sociaux, les responsables politiques et les gouvernements, ainsi que les employés des entreprises eux-mêmes, exercent une pression publique. Et cette pression commence par la prise de conscience collective des dommages que les réseaux sociaux causent à nos familles et à nos institutions. Elle s'intensifie lorsque les gens refusent le statu quo et exigent des changements pour le bien de tous. Et elle triomphe lorsque nous agissons collectivement : lorsque nous, citoyens, changeons notre façon d'utiliser les réseaux sociaux et exigeons des décideurs politiques qu'ils modifient également la leur.
Ce travail a déjà commencé. Les gouvernements et les responsables politiques ont accru leur pression sur les réseaux sociaux, notamment par le biais de nouvelles mesures antitrust et de transparence publique. Au sein des entreprises, les salariés ont commencé à faire grève et à s'opposer aux politiques, actions et outils incompatibles avec le bien commun ou l'éthique collective. « The Social Dilemma » a été le film le plus regardé sur Netflix en septembre, un record pour un documentaire. Des millions de personnes l'ont visionné et ont partagé les effets négatifs des réseaux sociaux sur leur vie.
Nous avons constaté le pouvoir de la pression publique lors de récents mouvements sociaux comme l'appel #EndSARS au Nigeria et la réforme de la police aux États-Unis, ainsi que dans les changements induits par le mouvement #MeToo. Plus les entreprises subissent de pression de la part des utilisateurs, des régulateurs et des employés, plus nous avons le pouvoir d'imposer un véritable changement. Aux États-Unis, nous avons commencé à voter lors d'élections où les enjeux sont plus élevés que jamais et où la confiance en la démocratie est exceptionnellement faible. Si les réseaux sociaux dominent notre sphère publique, nous devons veiller à ce que les principes démocratiques priment sur les profits. Nous, le peuple, avons le droit de gouverner les institutions qui façonnent nos vies. C'est cela, vivre en démocratie.
* Justin Rosenstein est le fondateur de One Project, une initiative visant à promouvoir la démocratie face aux défis de l'ère d'Internet, et l'un des sujets du documentaire « The Network Dilemma ». Il a auparavant contribué au développement d'outils comme Google Drive et le bouton « J'aime » de Facebook.
El País Espagne
Traduction de María Luisa Rodríguez Tapia