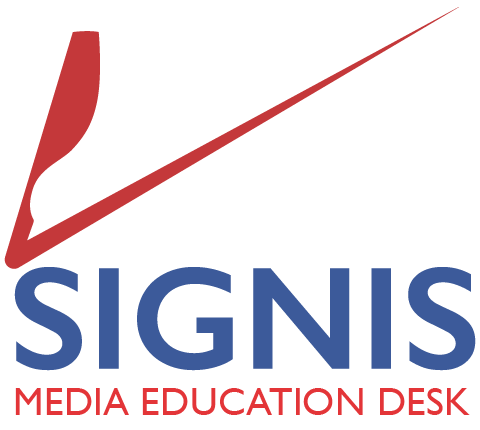David Le Breton, anthropologue : « Les réseaux sociaux réduisent le plaisir de vivre »

Le penseur français critique l'accélération contemporaine et l'obsession du corps, et propose un remède pour prendre de la distance avec le monde et apaiser l'esprit loin de la technologie : la marche. Presque un acte de rébellion
David Le Breton (Le Mans, 71 ans) a commencé ses travaux d'anthropologie en étudiant comment la société influence le corps humain (dans La Sociologie du corps , publié en Espagne par Siruela, comme ses autres livres traduits). Il a ensuite continué à travailler sur les comportements à risque des adolescents (consommation de drogues, sports extrêmes, participation à la violence) car il les avait lui-même vécus. Tout est né d’un besoin intérieur : le besoin de comprendre. « Je n’ai jamais écrit pour faire carrière, mais plutôt pour comprendre des problèmes intimes et pertinents qui m’ont affecté personnellement », dit-il. La nature de la douleur ou le désir de disparaître de soi-même (dans Disparaître de soi-même ) ont été d'autres de ses thèmes, une douleur et un désir qu'il ressentait également dans sa propre peau. Tout cela l’a conduit à ce qui est peut-être son thème de prédilection : la marche, qu’il considère comme une manière de s’éloigner du monde et de rechercher la tranquillité. Il l'explore dans Walking Life ou dans Praise of Walking . Dans son dernier livre, qui n’a pas été traduit en Espagne, il se demande si nous sommes arrivés au bout de la conversation : à Madrid, à Strasbourg, à Rio, il ne voit que des gens accrochés à leurs smartphones , marchant comme des zombies. « Je ne veux pas être moraliste ou critique, mais plutôt comprendre ce qui se passe autour de nous : c'est la tâche fondamentale de l'anthropologie », dit-il.
Le Breton a visité l'Espagne en février pour participer au Forum culturel de Valladolid et nous a accueillis, un peu timidement et souriant, dans un hôtel près de la Gran Vía de Madrid.
Demander. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre jeunesse qui vous a donné envie de disparaître de vous-même ?
Répondre. C'est difficile à dire, car je viens d'une famille normale, structurée, avec des parents qui m'aimaient. Mais, je ne sais pas pourquoi, depuis que je suis petite je me sens mal dans ma peau. Margaret Mead , l'anthropologue américaine, a déclaré que lorsqu'un jeune se sent mal dans sa peau, il étudie la psychologie ; Lorsqu'il se sent mal à l'égard de la société, il étudie la sociologie, et lorsqu'il se sent mal à l'égard des deux, il opte pour l'anthropologie. Ce sont mes domaines d’études.
Q. Et vous vous sentez mieux maintenant ?
R : Oui… J’ai fini par retrouver goût à la vie, mais je ne me reconnais pas dans le monde d’aujourd’hui, que je trouve violent, trop technologique, dans lequel on vit ensemble, mais dans la solitude. Je suis touché par la brutalité de la politique et de la géopolitique, c’est pourquoi je cherche refuge dans l’écriture. C'est ma bouée de sauvetage.
P. Le panorama donne envie de disparaître.
R. Il faut résister, trouver des raisons d'aimer la vie. La marche, par exemple, n’est pas seulement un refuge personnel, mais un refuge collectif. En Europe, 450 000 pèlerins font le chemin de Saint-Jacques . C'est une façon de montrer sa résistance. Ces marcheurs sont comme une assemblée internationale, pionniers d’un monde futur où la solidarité, l’amitié et la reconnaissance mutuelle seront primordiales, au-delà des désaccords religieux ou politiques. Et au-dessus des handicaps physiques.
Q. En plus de l’idée de disparaître, il y a ceux qui veulent être présents en tout. Et cela a beaucoup à voir avec les médias sociaux.
A. En fait, quand vous regardez l'écran, vous n'êtes nulle part, vous disparaissez. J'aime opposer la conversation à la communication : la première est en face à face, elle implique d'être attentif et de se regarder dans les yeux. Il y a place pour le silence, la lenteur, la complicité. La seconde est plus dispersée et utilitaire. L’écran est une sorte de bulle : il n’y a pas de sensorialité partagée.
Q : Si j’essaie de faire abstraction du bruit du monde, je constate que le bruit est intérieur : mon cerveau s’emballe et a du mal à se concentrer.
A. En effet. C'est pourquoi je recommande la marche comme une forme d'abstraction . Là, vous avez le vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, et cela conduit à un moment de paix intérieure. Nous pouvons penser à l’environnement, à nous-mêmes, à nos ancêtres.
Q. Pourquoi sommes-nous si accélérés ?
A. Nous sommes connectés à toutes sortes d’appareils, nous recevons des notifications tout le temps. Il me semble que le monde évolue plus lentement, car j’ai moins d’appareils. Mon rythme de vie est différent. Mais je le vois chez d’autres, qui vivent dans un état d’agitation permanente.
Q. Comment faites-vous cela ?
R. Je trouve cela facile quand on vient d'un monde qui n'était pas numérisé. Ma vie était basée sur la lecture, sur la recherche dans les bibliothèques. Mais aujourd’hui, on ne peut pas non plus vivre dos au numérique. J'essaie d'être celui qui domine le temps et de ne pas laisser le temps me dominer.
Q. On dit que nous vivons dans un monde plus émotionnel que rationnel, et que c’est mauvais.
A. L’humanité est émotionnelle et notre relation avec le monde passera toujours par les émotions. Mais auparavant, ces émotions étaient plus contrôlées, dans le débat politique ou dans les relations personnelles. Aujourd’hui, en effet, l’émotion a pris le pas sur la raison. Et cela peut avoir des conséquences tragiques. Par exemple, le wokisme : le monde est très complexe, il a beaucoup de nuances, mais l'émotion prévaut lorsqu'on l'aborde.
Q. Et la montée des positions autoritaires.
A. Oui, nous vivons dans un univers dominé par la colère et le ressentiment. Trump semble toujours en colère. À l'extrême droite, il y a toujours une excuse contre les minorités, qu'elles soient mexicaines ou arabes, il y a toujours le racisme et l'antisémitisme. Cela a aussi à voir avec ce moment émotionnel.
Q. Que fait la technologie à notre corps ?
R. Nous sommes entrés dans l’ère de l’humanité assise. Il existe des problèmes de santé publique tels que la sédentarité et l’obésité. Une étude révèle que dans les années 1920, au Royaume-Uni, un enfant courait autour de sa maison 10 kilomètres par jour. Maintenant, c'est 300 mètres. Et la passivité du corps implique aussi la passivité de l’esprit, ce qui a des conséquences politiques…
Q. Sans parler des problèmes d’auto-perception dont souffrent les jeunes.
R. Jamais dans l’histoire ils n’ont autant souffert d’anxiété, de dépression et de suicide. Les médias sociaux n’augmentent pas le plaisir de vivre, mais le réduisent plutôt.
Q. La gauche aspire à davantage de liberté, mais la droite agite le terme.
A. La liberté est un désir anthropologique, elle n’est ni de gauche ni de droite. Ce qui est inquiétant avec l’augmentation du temps libre, c’est qu’il pourrait finir par être capitalisé par les magnats de la Silicon Valley si nous le passons en ligne. L'important c'est d'utiliser son temps libre. Il existe des pays très avancés, comme l’Australie, qui fixent une limite d’âge de 16 ans pour accéder aux réseaux. Ce sont des mesures difficiles à mettre en œuvre, mais importantes.
Q. Ne savons-nous pas comment utiliser notre temps libre ?
R. Nous savons l’utiliser depuis longtemps, mais plus maintenant. Toutes les cinq minutes, les gens prennent leur téléphone pour vérifier les mises à jour. L’algorithme façonne nos vies. Et c’est la peur de la liberté de pensée. C’est pourquoi je vous appelle à vous rebeller, à être rebelles, à ne pas céder aux oligarchies technologiques. Que va-t-il se passer ? Comme Gramsci , je crois au « pessimisme de l’intelligence et à l’optimisme de la volonté ».