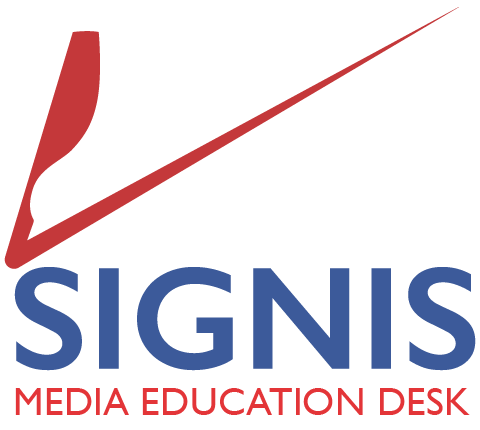Démocratie et éducommunication

DÉMOCRATIE ET COMMUNICATION ÉDUCATIVE
par Carlos Ferraro*
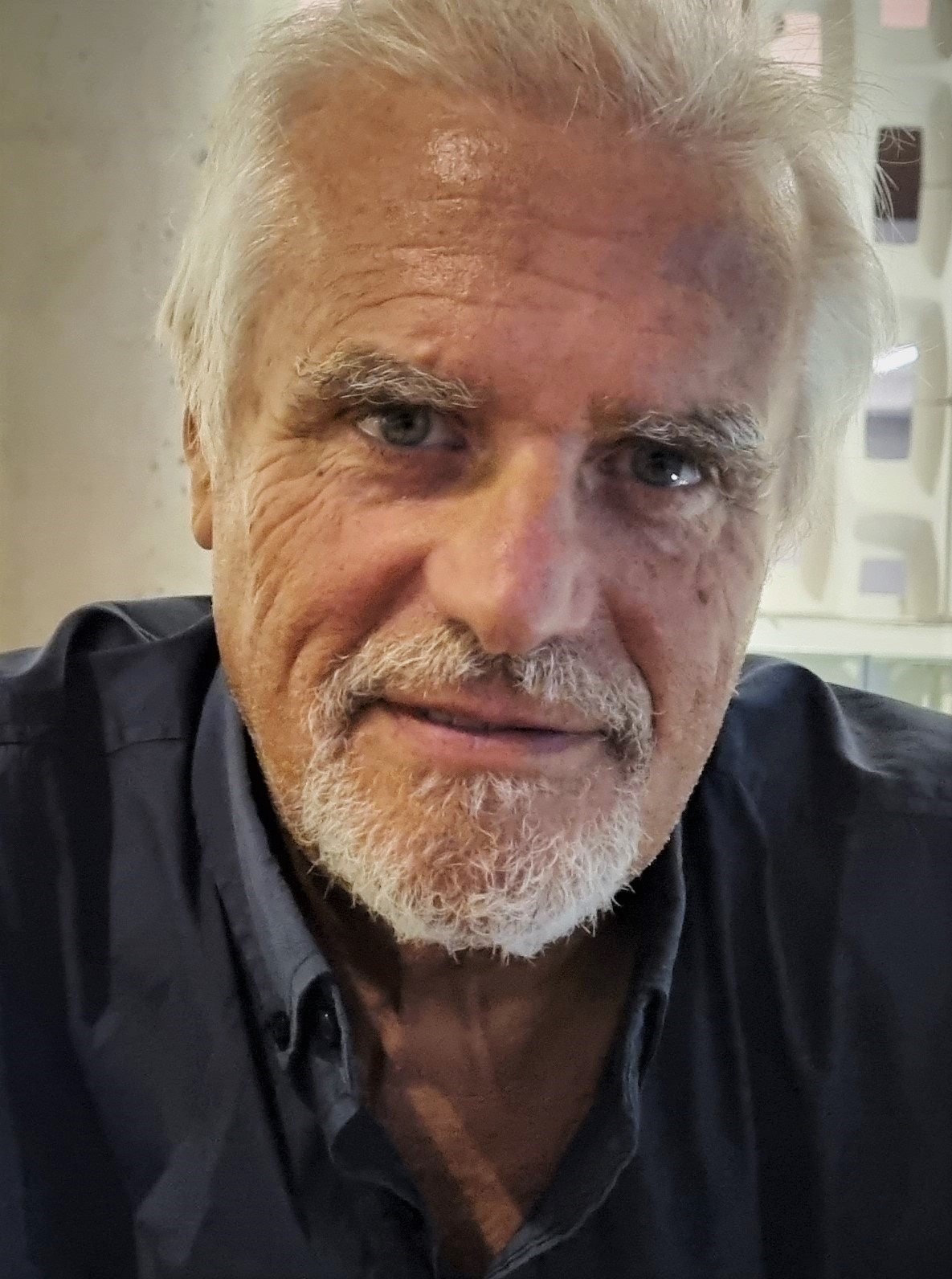
« La politique, selon la doctrine sociale de l'Église, est l'une des formes les plus élevées de la charité, car elle vise le bien commun. » - Source : Encyclique « Fratelli Tutti » (2020)
« La démocratie a besoin de vertu si elle ne veut pas être victime de ses propres mécanismes. » - Source : Encyclique « Fratelli Tutti » (2020)
Lorsque les pays dotés de systèmes démocratiques formels approchent des périodes électorales, il est courant d’entendre les citoyens se plaindre des hommes politiques, parler mal de la politique et, dans de nombreux cas, s’abstenir de commenter le sujet, arguant qu’ils ne s’y intéressent pas, n’y croient pas et s’en tiennent soi-disant à l’écart.
Il est courant de croire que la politique est le domaine exclusif des politiciens et de leur imputer la responsabilité de tous les maux qui surviennent dans le monde.
Dans la société, peu de gens comprennent que la politique est la responsabilité de ceux qui exercent le pouvoir et les représentent, et de ceux qui les ont élus à diverses fonctions publiques.
Cet argument, qui peut paraître élémentaire, contient pourtant l’essentiel de ce qui affaiblit le plus le système démocratique.
Personne d’autre n’est responsable de ce qui se passe – pour le meilleur ou pour le pire – dans les démocraties que la société civile elle-même et les citoyens qui la composent.
Le vote doit être conçu comme une lettre de pouvoir conditionnelle et provisoire envers le leader, résultat d’un processus de formation, d’information critique et fondamentalement de la conscience des valeurs qui construisent le bien commun dans sa portée maximale de la part du leader.

À quoi ça ressemble d’être citoyen ?
C'est une personne active et responsable qui doit s'intéresser et s'informer constamment de ce qui se passe dans le monde, dans la région où il vit, dans son propre pays et dans sa communauté d'origine.
Soyez suffisamment ouvert aux informations provenant de différentes sources, en évitant d’être catalogué dans celles qui ne montrent que la réalité qui correspond à vos croyances, tombant ainsi dans un biais informationnel et cognitif qui vous maintient dans une zone sûre de pensée et d’action.
Être citoyen, c'est comprendre l'économie, les enjeux géopolitiques, les droits de l'homme et avoir un regard sensible sur les groupes sociaux défavorisés. Comprendre le fonctionnement des médias hégémoniques, notamment à l'approche de la période pré-électorale. Analyser la réalité de manière critique. Apprendre à argumenter pour débattre. Exprimer et remettre en question ses propres idées et celles des autres. Écouter avec empathie. Dialoguer, guider, proposer et même donner de l'espoir.
Les citoyens doivent comprendre et accepter que la démocratie ne se résume pas au vote ; elle requiert leur participation active et continue en tant que protagonistes. Ils doivent apprendre à revendiquer et à défendre leurs droits et ceux des autres, et à veiller à ce que leurs représentants remplissent leurs mandats.
Il faut prendre conscience et pratiquer le collectif et la solidarité, et non l'individualisme, le « chacun pour soi ».
On pourrait penser que satisfaire ces exigences chez le citoyen ordinaire relève de l'utopie. Et c'est effectivement le cas. Cependant, qui pourrait prouver qu'un citoyen doté de ces accomplissements, de ces vertus et de ces capacités n'améliorerait pas substantiellement la démocratie ? Ou que la véritable démocratie est possible sans eux.
Il est courant d'entendre des politologues ou des sociologues remettre en question la validité de la démocratie en tant que système de représentation. Il pourrait être nécessaire de la repenser en termes de représentation ou de participation, en tenant compte des expériences des personnes qui la composent. Mais toute nouvelle démocratie nécessite des acteurs intéressés, impliqués, actifs et responsabilisés.

Il est inutile de rejeter la faute sur les autres et de se plaindre constamment de la politique. Il est inutile de prêcher : « Ils sont tous pareils », « Il n'y a pas d'issue », « Il est inutile de lutter contre le pouvoir », « Ils sont tous corrompus ». De telles pensées ou attitudes ne contribuent pas au changement, n'apportent aucune solution ; ce ne sont que des manifestations opportunistes qui soumettent l'individu au pouvoir dont il se plaint et, par la même occasion, affaiblissent la démocratie.
Il est impératif de comprendre que si je n’exerce pas et ne protège pas mes droits et ceux des autres, les intérêts d’un pouvoir illégitime progresseront par l’abus et la domination.
Il est vain de penser que la démocratie fonctionne toute seule. Il est faux de croire qu'en l'exerçant, chacun peut faire ce qu'il veut. La liberté, composante essentielle de la démocratie, exige des limites et des responsabilités de la part de tous les acteurs, dans leurs différents rôles et fonctions.
Bien que cela soit difficile et parfois compréhensible à accepter, il est nécessaire de considérer qu'en réalité, la plupart des politiciens ne sont pas corrompus. C'est même le cas. Il est injuste de ne pas reconnaître que nombre d'entre eux œuvrent, souvent avec un effort particulier, pour réaliser les idéaux auxquels ils se sont engagés afin d'améliorer la réalité. Il est juste de réfléchir aux réalisations et de s'efforcer d'examiner objectivement les actions qui apportent un changement pour le bien commun, quelle que soit l'idéologie défendue par le dirigeant. Il est impératif de comprendre que tout et tous ne sont pas identiques.
Le citoyen démocrate n'est pas un acteur statique. Il vit un processus permanent de développement civique. Il s'intéresse aux affaires publiques et les défend ; et même s'il n'en attend pas grand-chose personnellement, il est conscient de l'importance des politiques qui améliorent la qualité de vie de la collectivité.

Mais un citoyen est aussi quelqu'un qui doit entretenir sa mémoire. Il doit se souvenir des événements qui ont façonné la réalité d'aujourd'hui. La mémoire n'est pas un regard nostalgique ou plein de ressentiment. Elle nous permet de rendre présent le « passé réfléchi », afin de ne pas répéter ce que l'histoire politique récente ou passée nous enseigne comme devant changer pour obtenir de meilleurs résultats.
Si nous convenons que c’est ainsi que se forme la citoyenneté pour une démocratie pleinement fonctionnelle, il reste beaucoup à faire.
La première chose à laquelle nous pensons est le besoin d’éducation et de là nous arrivons à la question :
Quel type d’éducation forme un citoyen ?
Pensons d’abord à l’éducation qui ne devrait pas être .
Il ne peut s'agir d'une éducation fonctionnelle au système à transformer. Une éducation qui enseigne l'histoire sans esprit critique, sans dialogue avec l'apprenant. Une éducation qui ignore la dimension politique de la vie en société. Une éducation qui se contente d'enseigner la connaissance sans approfondir les valeurs. Une éducation fondée sur la méritocratie ou la compétition. Il ne peut s'agir d'une éducation entièrement basée sur la technologie. Il ne peut s'agir d'une éducation qui nie les différences. Il ne peut s'agir d'une éducation qui oublie d'enseigner la contextualisation, la pensée critique et l'émancipation de l'apprenant. Il ne peut s'agir d'une éducation où la réalité, objet d'étude ultime, est exclue de la classe.
Aujourd'hui, la pratique éducative s'inscrit dans un contexte idéologique incontournable : la montée de l'extrême droite, du populisme sous toutes ses formes, du néofascisme et du fanatisme idéologique qui mène au fondamentalisme sous toutes ses formes. Ces extrémismes nuisent au développement d'une éducation démocratique. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sujet ; les fractures, les polarisations et les préjugés ancrés dans la structure sociale en témoignent. Il est également impossible de construire une démocratie avec un système médiatique et social qui s'exprime par la violence symbolique, les mensonges appelés « fake news », la désinformation, les discours contradictoires, voire pervers et déshumanisants, qui alimentent l'imaginaire social.
Ainsi, pour le développement du citoyen, éducation et communication doivent être inextricablement liées. Il n'y a pas d'éducation sans communication, ni de communication sans éducation. Ceux qui comprennent l'éducommunication savent qu'elle construit une vision holistique de la réalité, qui allie savoir et différences et reconnaît la complexité. Elle développe la dimension critique et, en même temps, créative et intentionnelle qui ouvre la voie au changement et reconnaît la valeur de la communauté et du collectif.
Le changement social pour la démocratie ne peut être soutenu par des individus nihilistes ou sceptiques. En réalité, leurs discours deviennent dangereux car ils ne contribuent pas, ne construisent rien, sont vides de sens, créent un espace d'incrédulité et contraignent ceux qui sont confus ou à l'aise à un vide que d'autres combleront avec d'autres intérêts. En politique, les seuls espaces vides sont ceux que l'on est prêt à ne pas occuper ou à abandonner.
Les démocraties souffrent récemment d'une circulation de discours qui circulent avec la complicité du pouvoir politique et des médias hégémoniques, aggravée, dans certains cas, par le soutien du système juridique. Il est notoire que ces discours incitent à la diffamation, au discrédit et au cynisme, confinant souvent à la perversion. Nous assistons à une dégradation du discours politique qui aboutit à sa naturalisation et à son acceptation ultérieure par les citoyens. Les contradictions, la déformation des faits et la rhétorique excessivement agressive semblent insignifiantes ; la mentalité du « tout est permis » est acceptée.
Dans le paysage démocratique, on observe l'émergence de dirigeants proposant des solutions violentes et radicales aux problèmes. Le plus inquiétant est l'émergence d'une anomie sociale qui ne reconnaît ni ne répond à la faible qualité humaine des personnalités politiques. On accepte des dirigeants dépourvus de vision politique, de sensibilité envers le peuple, voire de solides connaissances pour gérer la complexité du pouvoir et les besoins réels du peuple qu'ils représentent.
La majorité des citoyens a oublié le principe essentiel de la démocratie, implicite dans le mot qui la définit et la désigne, « demos » (δ ῆ μος) qui signifie « peuple » et « kratos » (κράτος), c'est-à-dire ni plus ni moins : la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce directement ou par l'intermédiaire de ses représentants. De la Grèce antique à la Révolution française, avec sa matrice de démocratie libérale, la démocratie doit assurément être revalorisée en tant que système, mais en des termes nouveaux.
La première étape est simple et urgente : nous devons revenir à la source, en nous appuyant sur plus de 2 500 ans d’expérience démocratique pour savoir ce qui doit être corrigé ou changé. Et nous disposons également des connaissances nécessaires pour éduquer les citoyens afin d’y parvenir.

*Il est éducateur-communicateur, président de SIGNIS ALC et directeur du département d'éducation aux médias de SIGNIS Worldwide